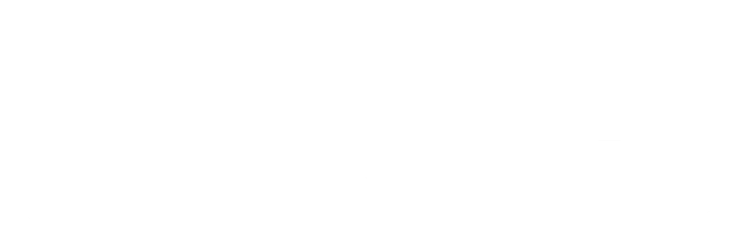Certification participative
Répondre au besoin de reconnaître les hommes de l’art dans le domaine de la construction vernaculaire
« Maintenir, entretenir le patrimoine bâti implique de savoir faire et de pouvoir transmettre. L’absence de cette maintenance entraîne la perte de ce patrimoine bâti. » (Chevallier, 1991).
La construction en terre crue appartient au domaine de l’architecture vernaculaire et repose sur la maîtrise de multiples savoir-faire. L’un des objets de la Confédération est la promotion et la défense des constructions en terre. Préserver le patrimoine, c’est aussi tirer du passé des enseignements pour améliorer les pratiques et répondre aux besoins du bâtiment d’aujourd’hui et demain (à ce sujet, voir notre atelier dédié au patrimoine bâti). Atteindre cet objectif sous-entend de maintenir les savoirs-faire, de les transmettre et de les améliorer.
Trouver des professionnels compétents répond à un besoin récurent de la part des maîtres d’ouvrage soucieux de la préservation de leur patrimoine et de la qualité d’exécution des ouvrages à réaliser. Ils cherchent à distinguer ces professionnel.le.s pour entrer en contact avec eux. Les annuaires et recensements de professionnels détenteurs de ces savoir-faire ont de tout temps été invoqués (Calame, 1988). En 2003, l’association Maisons Paysannes de France édite une enquête et un recensement national des professionnels du patrimoine bâti paysan par thématique où sont inclus des professionnel.le.s des constructions en terre crue.
À présent, les tentatives de distinguer les professionnel.le.s foisonnent. Pour s’y retrouver la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment, la CAPEB, édite un référentiel récapitulatif de tous les signes de garanties, sigles, mentions, appellations, certifications, etc. existantes en France (CAPEB Grand Paris 2019). Parmi ces qualificatifs, émerge un nouveau concept de démarches visant la qualité environnementale des bâtiments en adoptant un système participatif de garantie ou SPG. (DRIEAT IDF 2021 p.35).
Des labels certifiés par les pairs ou systèmes participatifs de garantie : les SPG
Le concept de SPG est théorisé et mis en pratique au sein de l’IFOAM dès 2008 (May C. 2019), « les Systèmes participatifs de garantie (SPG) sont des systèmes d’assurance-qualité avec une orientation locale. Ils certifient les producteurs en s’appuyant sur la participation active d’acteurs et sont basés sur la confiance, les réseaux sociaux et l’échange de connaissances, (IFOAM – Organics International, 2008). C’est un système de certification qui apporte la garantie de l’amélioration continue faite par ceux qui pratiquent ce métier pour leur bénéfice mutuel tout en préservant les ressources ou les biens communs de l’Humanité. Il s’agit d’un processus ouvert, horizontal, et transparent. Ce modèle de gouvernance prend appui sur la théorie des communs et ses applications (Ostrom, 1999).
Les systèmes participatifs de garantie (SPG), labels ou mentions certifiés par des pairs, sont
de plus en plus visibles dans le domaine de l’alimentation et du commerce dit équitable. L’association française Nature & Progrès a été un précurseur en la matière de ce qui deviendra plus tard le mouvement de l’agriculture biologique en rédigeant un premier cahier des charges dès 1972. D’autres secteurs d’activités se sont saisis de ce modèle de gouvernance, celui des données intellectuelles de la recherche par exemple, ou les logiciels libres en informatique. Dès l’origine, ces SPG suscitent la curiosité des intellectuels, des autoconstructeurs et des artisan.e.s en faveur de la construction vernaculaire, cependant sans jamais atteindre l’équivalent du succès ou de la reconnaissance du label BIO.
Dans le secteur du bâtiment, un SPG est initié à partir de 2009. Date à laquelle la démarche BDM, Bâtiment Durable Méditerranéen, devient opérationnelle. Elle comporte un référentiel d’auto-évaluation portant sur les aspects environnemental, social et économique, mais aussi un système d’accompagnement humain et technique pour tous les acteurs du projet, et une validation finale du niveau de performance atteint par le bâtiment par une commission interprofessionnelle (Buick 2012). Ce dispositif se décline à présent dans d’autres régions : BD Occitanie, BD EKOPOLIS en Île de France. Or, a contrario de la définition des SPG de l’IFOAM, BDM et ses suivants choisissent de certifier les bâtiments et non les structures ou les acteurs de la construction qui oeuvrent. Les bâtiments sont évalués au travers de tout ce qui les composent, dans leur globalité matérielle vis-à-vis de leur impact environnemental, en investissement et à l’usage.
Ces labels ou certifications participatives sont difficilement comparables, car ils ne portent pas sur les mêmes objets.
Le projet de label certifié par les pairs de la construction en terre crue
Après la publication du Guide des bonnes pratiques de la construction en terre crue en 2018-2020, s’est formé au sein de la Confédération un atelier prospectif sur le sujet des systèmes participatifs de garantie (SPG).
L’atelier de la Confédération, à la lumière des journées d’étude COMPAIRS de 2020 à 2023, et de l’analyse des SPG préexistants dans le secteur du bâtiment a pu définir son projet. Il compte dans un premier temps répondre aux enjeux des savoir-faire, pouvoir les transmettre, se reconnaître et se faire connaître à ce titre. On constate alors que doit s’opérer un double mouvement. Celui venant de la connaissance des matériaux et des constructions, de leurs caractéristiques, des résultats de recherches en laboratoires (à partir des travaux menés au Projet National Terre), avec celui de la certification participative, une organisation qui certifie que l’entreprise ou l’individu est en mesure d’obtenir sur chantier le résultat atteint en laboratoire.
À travers ce projet de certification participative ou de label certifié par les pairs, plusieurs objectifs sont donc visés :
- structurer la profession, faciliter l’interconnaissance professionnelle en interne et en externe ;
- améliorer, diffuser, transmettre les pratiques, les savoir-faire, établir des relais avec la formation initiale et continue et toutes les formes de diffusion des savoirs ;
- réviser et mettre à jour le texte de référence à visée normative : le Guide de bonnes pratiques de la construction en terre crue ;
- gagner la confiance de l’ensemble des acteurs du bâtiment notamment du contrôle technique et des assurances au sujet des constructions en terre.