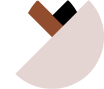
Glossaire

Le glossaire de la construction en terre crue est destiné à la fois aux professionnels de la terre crue et plus largement à tous, professionnels de la construction ou non, afin que chacun partage une culture et un langage communs. Il traite essentiellement de la construction en « terre crue », autrement dénommée « terre à bâtir », matériau utilisé depuis des millénaires sur toute la planète et toujours largement utilisé.
Les termes techniques spécifiques à une technique sont définis dans le glossaire particulier du Guide des Bonnes Pratiques concerné.
Guides

Les guides des bonnes pratiques sont au nombre de six, reprenant six techniques de terre crue en vigueur:
Il est à noter que le guide des bonnes pratiques des enduits en terre concerne les enduits sur supports autres que la paille et autre que les supports composés de terre crue pour lesquels des Règles Professionnelles existent déjà :
Casaux, F., Marcom, A., Meunier, N., & Morel, J.-C. (réseau Ecobatir, FFB, SCOP BTP, ENTPE), Règles professionnelles – Enduits sur supports composés de terre crue, éditions Le Moniteur, Paris, 2013. Traduction anglaise : French code of practice for plasters for earthen walls, C. de Gramont, T. Kremer, & E. Guillier, Eds.
Prochainement sur le site Maisons Paysannes de France :
le guide imprimé COMPLET des bonnes pratiques à acheter (format A5).
Contribuer
Les guides sont des documents évolutifs soumis aux retours d’expérience et commentaires des professionnels.
Si vous souhaitez compléter le travail initié, accédez au formulaire de révision du Guide :
Pour être prise en compte dans les discussions, toute modification de texte doit absolument être :
• Insérée dans le formulaire, en respectant les cases de chaque colonne
• Accompagnée d’une proposition de reformulation
• Identifiable par votre nom inscrit dans la colonne
• Rédigée de manière courte.
Adresse de dépôt des remarques et reformulations : gbp@conf-terrecrue.org
Poursuite du recueil de données environnementales
En 2021, la Confédération de la construction en terre crue a réalisé des fiches de déclaration environnementales et sanitaires ou FDES collectives sur les matériaux et les techniques avec adobe, bauge, pisé, terre allégée et torchis (https://www.inies.fr/inies-et-ses-donnees/fdes-produits-de-construction/). La Confédération Terre crue souhaite continuer à récolter des données environnementales et sanitaires de toutes les pratiques en terre crue. C’est pourquoi, elle sollicite les constructeurs, et les entreprises à remplir le questionnaire à télécharger ci-dessous. Si telle est votre intention, veuillez s’il vous plaît vous faire connaître à l’adresse contact@conf-terrecrue.org afin de bénéficier d’un éventuel accompagnement.
